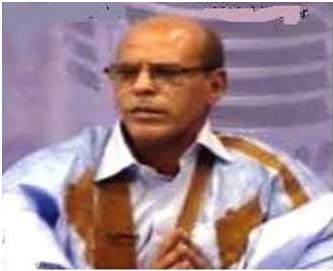
Aussi paradoxal que cela puisse paraître au regard de ceux qui mesurent l’écart entre le système démocratique tel qu’il est théoriquement et admirablement organisé par notre actuelle Constitution et celui dominant la Mauritanie où rien n’échappe aux chefferies tribales qui sont demeurées essentiellement esclavagistes.
Le désir sincère, mais naïf, de fonder un État national assurant l’égalité entre communautés et entre citoyens a conduit la première équipe de nos dirigeants à se doter de la Constitution du 22 mars 1959 poursuivant le mirage d’une démocratie parlementaire. Mais les premiers cadres, le Président Moktar Ould Daddah en tête, prirent conscience de l’impossibilité de faire progresser le pays à cause de l’emprise des forces millénaristes sur les rouages du jeune État. Les péripéties de cette phase de notre histoire ne sont pas le sujet principal du présent propos, même si les générations montantes ont droit d’en avoir un aperçu pour les apprendre et les méditer. Pour l’instant, il faut retenir que ladite Constitution devait être remplacée par une autre pour instaurer un système présidentiel à l’image de celui de l’ancienne métropole.
La Constitution du 20 mai 1961 inaugura l’ère d’une une lutte acerbe, mais intelligente, tant ouverte que voilée, opposant jusqu’au putsch du 10 juillet 1978 les féodalités et autres forces obscurantistes d’une part et, d’autre part, un exécutif fédérant alors les forces tant soit peu conscientes de la nécessité de reconstruire l’Etat sur des bases prenant en considération l’aspiration légitime et unanime des citoyens à l’honneur, à la fraternité et à la justice. Cette devise fut et demeure la quintessence du fondement de notre semblant d’État où chaque citoyen a théoriquement droit à la plénitude de sa dignité, ce qui exclut toute forme de subordination personnelle ancienne ou moderne, où les liens de fraternité entre tous sont réputés sacrés et où l’égalité devant la Loi est à la base de tout.
Plus tard, une loi de 1968 prononça la dissolution des communes tant urbaines que rurales et leur remplacement par des collectivités régionales administrées par des conseils nommés par le Gouvernement. Les collectivités décentralisées dissoutes étaient réparties en trois catégories plus adaptées à leur contexte sociologique et à leur environnement institutionnel du point de vue de leur statut et de leurs domaines respectifs d’intervention. Mais, au regard du pouvoir exécutif, elles servaient aux forces traditionnelles de tranchées ultimes pour la résistance contre le camp de la modernisation et de la rénovation des institutions publiques.
Défis immenses
Dans le contexte surréaliste créé par le nouveau cadre institutionnel fortement centralisé, la volonté des forces de progrès ne pouvait s’imposer facilement aux chefferies tribales et spirituelles qui dominaient et dominent encore le monde d’ici-bas. Les nouveaux dirigeants devaient nécessairement prendre acte de ce rapport de force délicat et trouver des formes de compromis leur évitant une confrontation à laquelle ils n’étaient guère préparés. Pour se vanter d’avoir créé un pays de toute pièce, ou justifier leur paresse et leur manque d’imagination, les Mauritaniens aiment rappeler qu’au moment de leur indépendance, ils étaient démunis de ressources matérielles et infrastructurelles. Ils oublient, que leur élite intellectuelle et technocratique n’avait subi aucune préparation pour relever les défis immenses auxquels elle était confrontée.
L’on comprend dès lors que dans ce contexte de précipitation, les Mauritaniens aient construit leur capitale sans vérifier la viabilité de son emplacement et sans même décaper le terrain pour fonder leurs immeubles sur un socle sécurisant. Bien plus graves auraient été la précipitation du débat politique et l’absence de débat culturel précédant la fondation de l’État, ce dernier ayant alors pris l’allure d’un simple assemblage mécanique d’ethnies, de confédérations tribales et de formations émirales mal achevées dont le festin était parfois troublé par l’émergence de tribus satellites, de grands cadres sortis du néant social grâce au hasard du système moderne d’enseignement ou de riches compradores entrés par effraction dans la vie politique.
La fragilité de cet assemblage mécanique avait imposé un compromis originel qu’il fallait faire accepter en traçant une ligne de séparation infranchissable entre la gestion de l’État et celle du champ politique. Toutefois, la prise en considération des exigences de la première était privilégiée lorsqu’il n’y avait aucun moyen de concilier ces deux modes de gestion.
La nomination des membres du gouvernement, des ambassadeurs, des gouverneurs et des hauts fonctionnaires obéissait uniquement à des critères de compétence excluant tout argument tiré de la nécessité de répartir équitablement les opportunités de ce genre entre les tribus, les régions et les ethnies. Le recrutement des agents de la Fonction publique s’organisait sur la base de règles strictes auxquelles aucun responsable, y compris le Président de la République, ne pouvait déroger.
Même à l’apogée de leur hégémonie, les Secrétaires fédéraux du Parti unique demeuraient soumis aux gouverneurs de région et ne pouvaient intercéder au profit d’un délinquant sans courir le risque d’être poursuivis pour tentative d’entrave à la Justice. De très nombreux exemples peuvent étayer cette assertion, mais nous en citerons un seul qui suffit à illustrer ce propos. En 1973, il y eut un conflit personnel entre Abderrahmane Ould Cheine dit Deibba, Secrétaire fédéral du Hodh Charghi et Moustapha Ould Mohamed Saleck, alors gouverneur de ladite région. Alors qu’elle s’attendait à la relève inévitable du second, l’opinion publique fut désemparée par l’affectation du premier comme adjoint au gouverneur de Dakhlet Nouadhibou. Et, lorsque les membres du Bureau politique du Parti du Peuple Mauritanien exprimèrent leur étonnement de cette décision, le Président Daddah se contenta de leur faire remarquer qu’ « un Etat peut exister indéfiniment sans parti, alors qu’il ne peut durer un jour sans administration territoriale ». Ce postulat fondateur irréfutable permettait de maintenir l’État avec son administration civile et militaire et sa magistrature hors marécages de la vie politique dans lesquels il laissait aux forces traditionnelles et aux cadres du Parti le loisir de patauger.
En dépit du respect absolu de ce compromis existentiel, l’État accordait des marques de considération aux chefferies traditionnelles en « laissant le temps au temps » de produire ses effets inéluctables. Tel était, du moins, l’entendement de cette génération d’hommes et de femmes dont la Mauritanie eut la chance de bénéficier au moment de son indépendance. L’Administration n’était pas pressée de supprimer brutalement le leadership tribal, mais elle y procéda par extinction, si bien que le Ministère de l’Intérieur avait versé en 1989 des cadeaux-soldes à 713 chefs traditionnels en tant qu’auxiliaires des autorités territoriales.
C’est à partir de l’avènement de la démocratie pluraliste clonée par la Constitution de 1991, que ce verrouillage entre gestion de l’État et celle de la vie politique a sauté en donnant l’illusion que le pays avait réalisé un grand progrès. En réalité, nous avons applaudi à la hâte, à cause de la soif de liberté, à un recul considérable ou la fin d’un compromis essentiel qui protégeait l’État des éclaboussures d’une gestion politique inévitablement marécageuse. Nous nous sommes rendu compte que ce déverrouillage a agi exactement comme l’aurait fait la suppression de la séparation entre notre réseau de déversement à l’égout et celui de notre conduite d’eau.
Compromis existentiel
Les équipes d’officiers qui ont dirigé le pays avaient, sans exception, des motivations nobles et une volonté de préserver l’État contre les méfaits du népotisme, de l’ethnocentrisme et de la soumission à des forces sociales ayant des intérêts contraires aux exigences de la société égalitaire dont nous avons urgemment besoin. Mais, par inexpérience, ces juntes sont toutes tombées dans le piège de groupes d’intellectuels civils ayant des mobiles personnels, tribaux ou ethniques et se référant à des sources idéologiques aussi sectaires qu’utopiques.
Ces groupes se sont ingéniés à empêcher le changement du 10 juillet 1978, qui répondait pourtant à une aspiration largement partagée, de revisiter les bases de l’unité nationale secouée par une approche inadéquate en matière de gestion de la diversité et un usage inopérant de raccourcis se référant de manière simpliste à la communauté de religion, aux liens de sang entre les ethnies, etc. Ils avaient encouragé les dirigeants militaires à assassiner la langue arabe par l’arme de l’arabisation à outrance et la charia islamique par la schématisation abusive et la banalisation du statut des magistrats.
La découverte par les juntes militaires successives du chemin de ce qu’elles prennent pour une démocratie leur a offert l’occasion rêvée de combler leur déficit de popularité et d’expérience et de conclure un pacte avec les chefferies tribales, quitte à ramener le pays deux siècles en arrière. En application de ce pacte, elles ont transformé en parti politique l’immense corps des auxiliaires de l’Administration que formaient et forment encore les chefs de tribu et de village.
Tout le génie malfaisant de l’élite administrative s’est mis alors en marche pour concevoir et mettre en œuvre un système électoral formellement difficile à attaquer, mais servant quant au fond les intérêts d’une alliance quadripartite sacro-sainte entre le Capital impropre, la haute bureaucratie improvisée, l’aristocratie militaire et les forces tribalo-esclavagistes.
Au sein de cette alliance, les rôles sont bien répartis aux deux niveaux de la hiérarchie de l’État. Au niveau central, la coordination entre lesdits acteurs est assurée par le Parti-Etat qui sert de secrétariat au chef de l’Exécutif et de collecteur de fonds auprès des hommes d’affaires en attendant qu’ils récupèrent par le système des marchés publics de gré à gré. Au niveau territorial, les walis et les hakems cachent leur ingérence décisive dans les élections en tirant discrètement sur la loge des chefs de tribu et de village qui sont incapables de tricher, même s’ils le désirent, en laissant leurs contribules voter librement.
La dispersion de la population en une infinité de villages et la correspondance parfaite entre l’identité spatiale et l’identité onomastique sont arrivées au point qu’aucun chef traditionnel ne peut dissimuler la préférence des siens lors d’un vote. C’est pourquoi, dans les centres urbains et semi-urbains où cohabitent plusieurs entités, l’on constate que les votes reflètent la diversité des opinions, alors que les résultats des bureaux de vote des villages ruraux sont toujours favorables aux candidats présentés par l’Administration. Pour cette raison, le Gouvernement encourage l’afflux des électeurs des centres urbains vers les zones rurales, car il peut ainsi contrôler leur vote de la plus grande d’électeurs possible.
Par ailleurs, les listes de candidats présentées par le Parti-Etat sont formées uniquement, à de rares exceptions, de personnes issues des grandes familles. Les haratines et autres castes n’y occupent, sauf exception rarissime, que des places subsidiaires. La présentation des cadres haratines expose au risque de déréguler le marché électoral, chaque élection inaugurant un vaste marché de vente des électeurs. Les notables esclavagistes y exposent, aux enchères publiques, des dizaines de villages de haratines prêts à voter selon les ordres donnés par leurs vendeurs respectifs. Le produit de ce marchandage macabre des voix de milliers d’anciens esclaves sur la place publique de Nouakchott et d’autres villes bien connues est directement versé à des cadres promus, pour récompenser les chefs tribaux qui les ont destinés à des postes de responsabilité pour lesquelles ils n’ont jamais été formés. Ce marchandage a deux conséquences majeures sur l’État qu’elles assassinent inévitablement. D’abord la disparition de la Fonction publique du point de vue du respect des statuts, de l’obligation de réserve du fonctionnaire et de l’adéquation entre les postes et le contenu des formations. Les soi-disant cadres ou extraterrestres ainsi nommés se servent librement et impunément des ressources publiques financières et matérielles et, en attendant d’autres échéances électorales, se mettent à blanchir leur turban en distribuant des miettes à des notables de leur communauté. Le cercle vicieux se forme alors en commençant par la vente des électeurs issus d’anciens esclavages ou des castes ou « gnegnibéé » comme ils sont appelés en pular. Il se termine par la formation d’une cohorte de fonctionnaires qui, bien qu’orphelins sociaux, ont le pouvoir de légitimer et de délégitimer les régimes politiques et le droit à l’impunité totale.
Marchandage macabre
L’on se rend compte dès lors du fait indéniable que l’État puise sa légitimité du suffrage universel formel comme ses suppôts le rappellent à chaque instant en se prévalant du statut de majorité, du verdict des urnes et autres arguments fallacieux. Toutefois, les gouvernants ne peuvent prétendre que le résultat de ces urnes soit autre que celui de la volonté d’un système tribalo-esclavagiste qui profite d’une formalité pour faire valoir ses intérêts, se livrer à ses pratiques honteuses et contrôler subrepticement un État qui lui a échappé pendant une trentaine d’années.
La démocratie ainsi comprise, fondée et gérée par nos gouvernants promet donc de beaux jours à ce système anachronique qui se trouve à mille lieues de nos aspirations profondes. Elle exclut toute perspective d’inauguration d’une ère d’émancipation sociale réelle et de participation à la vie politique qui permette à chaque Mauritanien de conjuguer d’abord son identité au singulier avant de choisir celui à qui il confie son destin.
L’essentiel doit être pour nous de reconnaitre que nous avons tous fait preuve d’une naïveté mortelle en faisant foi à une démocratie ayant pour tête les militaires et pour jambes les chefferies tribalo-esclavagistes. Notre péché est d’autant plus difficile à absoudre que nous avons appris dans nos manuels d’histoire que la démocratie n’a jamais été octroyée ou décrétée, fut-ce par le plus éclairé des timoniers. Les peuples en ont toujours payé le prix en agissant pendant des années pour détruire le couvercle incandescent des dictatures monarchiques, coloniales ou militaires.
Comment pouvons-nous prétendre vivre dans une démocratie dans un pays où les personnes ont un statut social avant leur naissance, où les majorités se forment par instinct épidermique, tribal ou régional et où les citoyens se vendent publiquement sur le marché électoral ? Je suis sûr qu’aucun Mauritanien ne se trompe sur la réponse à apporter à ces questions et que nous sommes tous conscients de la nécessité pour notre pays d’adopter un nouveau système politique faisant table rase de notre passé institutionnel et répondant aux exigences de consolidation d’un l’État à refonder sur des bases unitaires plus consensuelles, d’un droit effectif et inaliénable au bonheur de vivre dans la dignité, d’un égalité réelle entre citoyens, régions et ethnies et d’un partage équitable des ressources et des opportunités publiques.
La réponse à ces exigences fondamentales amène à suggérer une révolution pacifique contre le système tribalo-esclavagiste qui divise le pays et empêche l’émancipation de la majorité des hommes et des femmes de mettre en œuvre un mode de représentation et d’expression adapté à nos valeurs multiculturelles. Une révolution qui ouvrira la voie à une évolution positive de notre pays qui devra, dès lors, accorder une moindre importance à la question de savoir qui aura à le diriger. A priori, il n’y a guère de raison d’affirmer que ceux qui dirigent le pays sont pires que ceux qui s’opposent à eux, car les deux camps sont faits du même tissu. Il n’y a que le dessin qui diffère selon toute vraisemblance et le degré d’aptitude à supporter le désordre inhérent à un État beidane qui ne finit pas de mourir. Nous pouvons donc nous mettre à l’œuvre et nous entendre sur un pacte national redéfinissant un autre système de représentation politique garantissant une représentation effective de tous ceux, parmi nous, que nous avons maintenus dans la servitude et nous exploitons honteusement l’amertume, l’isolement géographique, l’ignorance et la pauvreté.
Mais la grande question qui se pose est de savoir si les acteurs politiques feront preuve d’humilité et de sacrifice pour descendre de leurs chars respectifs afin d’avoir, plus tard, à payer le prix de leur naïveté et de leur entêtement ou continueront à courir derrière une démocratie clonée au service d’un système tribalo-esclavagiste qui nous conduira vers des rivages embrasés !!!!
NB :
Comme à chaque fois qu’il intervient dans la presse, l’auteur de ces lignes suscitera probablement une réaction lui rappelant qu’il a exercé de hautes responsabilités dans les régimes précédents, comme pour le priver du droit de s’exprimer. Il est disposé à comparaître devant la justice au cas où sa comparution pourrait résoudre un problème pour le pays. Mais il dira d’emblée qu’il a servi loyalement le Président Maouiya Ould Sid’Ahmed Taya, qu’il est encore disposé à le servir, car il ne lui a jamais ordonné de faire du mal ou interdit de faire du bien.
Par Isselmou Ould Abdel Kader
