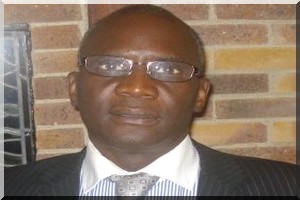 Kassataya – Il faut rechercher la vérité dans les faits. Et les faits, comme la vérité, sont têtus. La vérité linguistique en Mauritanie est la suivante: il existe quatre langues nationales définissant les quatre communautés ethnolinguistiques du pays.
Kassataya – Il faut rechercher la vérité dans les faits. Et les faits, comme la vérité, sont têtus. La vérité linguistique en Mauritanie est la suivante: il existe quatre langues nationales définissant les quatre communautés ethnolinguistiques du pays.
Car la langue est le principal critère d’identification d’une ethnie. On est » Hal Pular » d’ethnie parce que c’est dans la langue « peulh » que l’on s’exprime, de naissance ( la fameuse » langue maternelle »). On est Soninké, olof et arabe, pour cette raison et uniquement pour cette raison.
Un peul » rouge » ( Pullo boďeejo) est un Hal Pular autant qu’un » toucouleur » (pullo baleejo). Leur différenciation « physique » (mille nuances de couleurs!), provient du processus historique de leur constitution, notamment les conquêtes peules originelles, les mariages etc…, et finalement, leur fusion dans un ensemble sociétal unique, commun, dont la base économique et sociale est tissée et symbolisée par leur désormais langue commune ( processus d’assimilation interactif qui explique à la fois l’unité et la diversité de l’ethnie finale qui en est résultée…).
Ce processus est probablement identique dans les autres ethnies négro-africaines. Mais il est absolument identique dans l’ethnie dite « maure » ( dont la racine, faut-il le rappeler, est grecque -mavré- et signifie…sombre ou noir!). Cette ethnie » maure » est légitime à se qualifier d’arabe, précisément parce que, de la même façon que pour les halpular, ses composantes » raciales » sont unies par le même socle, la même base linguistique en laquelle elles se reconnaissent: le Hassaniya.
Mais le Hassaniya est un dialecte de l’arabe, c’ est à dire, un parler local, une variante de la langue arabe dans laquelle s’expriment les populations centrales du grand Sahara et de ses alentours soudano-sahéliens. Les linguistes, les anthropologues, les historiens et les géographes, notamment, sont tout à fait d’accord sur ce fait.
Pour diverses raisons historiques, ce hassaniya serait même très proche syntaxiquement et lexicalement, de l’arabe « originel » des confins yéménites actuels. Bien sûr, le hassaniya comme dialecte de l’ arabe tire certains de ses traits caractéristiques du métissage des conquérants arabes avec les populations autochtones de notre espace regional, en particulier les grandes tribus berbères dont les langues ont été graduellement absorbées puis assimilées avant de disparaître quasi-totalement chez nous -et non au Mali, au Maroc, en Algérie etc.
Mais ce hassaniya a également fait des emprunts incontestables aux langues autochtones négro-africaines trouvées sur place, spécialement soninké et bambara, qui étaient, de loin les principales ethnies dominantes dans la région, à l » époque des prestigieuses civilisation des puissants Empires du Ghana et du Mali.
Fondamentalement, le hassaniya tirant sa structure de base ( grammaire notamment) de l’arabe, il constitue bien un dialecte de l’arabe, comme le parler pular de chez nous n’est qu’un dialecte de la langue peul ( comme ses autres variantes dans la plupart des pays africains où est parlée cette langue, de Mauritanie en Éthiopie, de Guinée au Soudan etc.).
Cette ethnie arabe est également à la fois unie et diverse dans sa composition. Unité linguistique fondée sur une intégration dans un même ensemble sociétal dont l’un des aspects saillants est la division en castes comme pour les autres ethnies du pays d’ailleurs, et les liens entrecroisés d’une multitude de tribus, clans, familles etc.
C’est dans cet ensemble que s’est façonnée une structure sociale laissant apparaître deux grandes « nuances » de couleurs recoupant également des positions sociales complexes: les Bidhanes ( blancs) et les Soudanes ( noirs). Le mode de production esclavagiste puis féodal, va assigner, à chacune de ses composantes, un statut social particulier, même si le métissage et la porosité statutaires introduisent des éléments beaucoup plus complexes que les simplifications d’usage donnent à penser.
Les Bidhanes sont pour l’essentiel des hommes libres même si nombre d’entre eux sont à statuts ( forgerons, griots etc.). Les Soudaan sont, à l’apposé, soit d’anciens esclaves devenus libres (hrattines) comme les « slaves » d’Europe Centrale!
– ce sont de très loin les plus nombreux- soit des esclaves statutaires ( une minorité encore visible, taillable et corvéable surtout à la campagne), soit des hommes libres depuis l’origine ( khadaara). Baydanes et Soudan appartiennent donc à la même communauté arabe du fait de leur communauté de langue et des liens sociétaux qui les différencient de ce double point de vue, des communautés voisines ( surtout négroafricaines) même si ils partagent avec ces dernières la même couleur de peau et certains traits culturels tirés de leur proximité historique et géographique.
La vérité est donc que les Soudaan ( les « hrattines » comme on dit maintenant par extension) sont, non seulement arabes par ces 2 traits évoqués, mais même sont majoritaires au sein de la communauté arabe. Ce sont eux qui font des arabes la majorité absolue de la population du pays. Leur singularité raciale ( peau » noire), ne change rien à l’ affaire.
Le Soudan est l’un des pays les plus importants des pays arabes. C’est un pays de noirs. Il en va de même de la Somalie. La couleur, nulle part, n’identifie une ethnie ( une » nationalité).
Le problème véritable est que cette composante fondamentale de la population de notre pays, fait l’objet de discriminations tellement massives, une partie de l’élite « blanche » arabe est tellement bornée et réfractaire à l’ égard de ses plaintes, et l’Etat si aveugle vis à vis des risques que fait courir au pays la non solution de leur probleme- que tout ce beau monde est en train de fabriquer une « césure » ethnique au sein même de cette communauté, un peu comme aux Etats unis, le ségrégationnisme a provoqué la naissance « ethnique » d’une communauté noire dont les membres partagent la même langue que le reste de la population mais dont cette ségrégation exclut de fait de la communauté nationale américaine.
Cette même petite minorité au sein de l’élite arabe blanche agissant de la même manière discriminatoire à l’encontre des membres des communautés négroafricaines au nom de l’arabité exclusive de la Mauritanie, provoque les tendances au rapprochement politique des élites hartani et négroafricaine sur une base raciale de rejet de la domination élitaire blanche du pays, déplaçant peu à peu l’ un des aspects saillants de la lutte pour la démocratie effective en Mauritanie, sur le terrain ethnique et racial.
Le sectarisme au sein des différentes élites « communautaires » du pays bat donc son plein, au détriment de la cohésion nationale, des règles de la citoyenneté et de l’Etat de droit, avec comme principaux responsables, ceux qui sont aux commandes l’Etat et gouvernent par la.manipulation des opinions, au détriment de la paix et de la grande unité du pays.
Gourmo Abdoul LO
Le 8 février 2017
Source : Cridem.org
