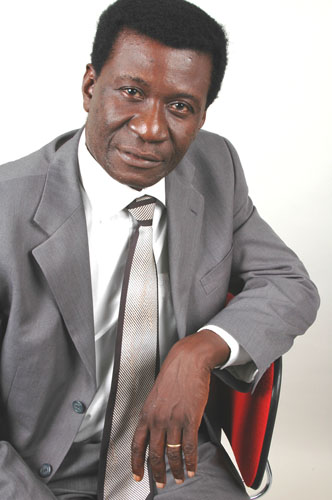|
INTERVIEW DE TIDIANE N'DIAYE
La mémoire vive
Spécialiste de l'histoire africaine,
Tidiane N'Diaye crée la polémique avec son livre sur la traite négrière
arabo-musulmane 'Le Génocide voilé'. Interview en deux temps d'un anthropologue
subversif et téméraire.
'Le Génocide voilé' décortique un sujet brûlant : la traite négrière
arabo-musulmane. S'il semble, aujourd'hui, aisé de parler de l'esclavage
transatlantique, ce n'est pas le cas pour celle concernant la partie
subsaharienne. Il existerait comme un silence, un mutisme autour d'une ponction
en hommes, en matières et surtout en vies de l'Afrique noire, par les Arabes à
partir de 652. L'occasion audacieuse mais légitime en ces temps de controverses
de revenir sur une histoire sombre et voilée coupable, selon l'intellectuel
sénégalais, d'un véritable 'génocide'. Ou quand la mémoire se substitue à une
cécité persévérante.
Le 'Génocide voilé' est une enquête sur la traite
arabo-musulmane. Pourquoi s'intéresser à ce sujet aujourd'hui ?
Parce que les misères, la pauvreté, la longue stagnation démographique et
les retards de développement actuels du continent noir, ne sont pas le seul
fait des conséquences du commerce triangulaire, comme bien des personnes se
l'imaginent. La ponction transatlantique nous est bien connue et est largement
débattue depuis des décennies. Les études et synthèses sur cette traite sont
légion. Pourtant, bien qu'il n'existe pas de degrés dans l'horreur ni de
monopole de la cruauté, on peut soutenir que le commerce négrier et les expéditions
guerrières provoquées par les Arabo-musulmans furent pour l'Afrique noire et
tout au long des siècles, bien plus dévastateurs que la traite transatlantique.
De même que l'islamisation de nombreux peuples négro-africains et tout ce que
cela a engendré, comme le djihad, n'en fut pas moins à la source d'innombrables
implosions. Mais à ce jour, seul le génocide des peuples noirs par les nations
arabo-musulmanes, n'a toujours pas fait l'objet de reconnaissance nette de la
part des chercheurs des peuples responsables. Alors que ce crime est
historiquement, juridiquement et moralement imprescriptible.
Quand a-t-elle commencé et dans quelle(s) région(s) ?
Dès le VIIe
siècle de notre ère, les Arabes ayant conquis l'Egypte, allaient y asservir de
nombreux peuples venant de la Nubie, de Somalie et du Mozambique ou d'ailleurs,
au cours de la première expansion islamique. Les Nubiens avaient été durement
secoués par les foudroyantes attaques des forces arabes. Ils se défendirent
courageusement, mais, devant une supériorité numérique et la détermination des
soldats du djihad et les assauts répétés des "djihadistes" arabes,
les Nubiens préférèrent négocier la paix en concluant en 652 un traité connu
sous le nom de "Bakht". Ce traité engageait le monarque africain vaincu
à livrer annuellement un lot de 360 captifs destinés à être asservis dans le
monde arabo-musulman. C'est ainsi qu'une traite négrière en grand, fut pour la
première fois inventée par les Arabo-musulmans. J'emploie le terme
d'arabo-musulman car après le "Bakht", ce trafic deviendra
transsaharien et oriental en impliquant de plus en plus de peuples et de
régions qui débordaient largement l'univers arabe. Les négriers qui y ont
trempé étaient aussi Berbères du Maghreb, Turcs sous l'Empire ottoman ou Iraniens
donc des Perses. De nombreux captifs africains seront même vendus par les
Arabes jusqu'en Inde puisque le roi du Bengale en possédait près de 8.000 au
milieu du XVe siècle. La majorité des hommes déportés aux débuts de ce trafic,
était prélevée sur les populations du Darfour. Tout avait commencé là et cela
n'a apparemment jamais cessé.
Quelles sont la forme spécifique et les motivations
de cette traite comparée à la traite transatlantique ?
Dans le monde arabe - le système wahhabite (Arabie Saoudite) par exemple -,
ne favorisait pas un développement économique et social par le travail de ses
habitants. Il les condamnait à un appel incessant de main-d'oeuvre servile
fournie par la traite négrière. En outre, pour un Arabe de cette époque-là,
l'homme n'est jamais pauvre, tant que son voisin possède quelque chose. La
guerre sainte tombait à pic, pour s'enrichir. Puisqu'obligation est faite à
tout croyant de mener le djihad, se disaient-ils, il fallait soumettre et
asservir les non convertis. Ils prenaient abusivement le Coran comme prétexte,
pour razzier les voisins infidèles, en les dépouillant de tout ce qu'ils
possédaient. C'est ainsi qu'en toute bonne conscience et par des moyens aussi
commodes que bénis, la plupart de ces tribus arabes converties, finissaient par
ne plus vivre par elles-mêmes. Ainsi la constante du fléau de la traite
négrière et de l'esclavage arabo-musulman en Afrique, était due aux traditions
de ces peuples, au cours d'une époque où ils ne pouvaient, pour des raisons de
débauche et de paresse, se passer d'hommes serviles, pour leur infuser des
forces et du sang neuf. Par exemple, au milieu du XIXe siècle, un tiers de
la population d'Oman était africaine ou d'origines africaines. Dans ces
sociétés arabes, les Africains jouaient un rôle presque central. Sans fonctions
précises, ils prenaient une grande part aux activités communes.
Vous évoquez la pratique de la castration
massive...
Avant les terribles opérations de castration il y eut d'abord razzias et
massacres. Par exemple, la seule guerre sainte menée par ce chef arabe
soudanais, mystique, illuminé et qui se prenait pour un Mahdi (descendant du
Prophète) : tout le Soudan depuis l'océan jusqu'en Egypte englobant tous les
plateaux de l'Afrique - du Nil jusqu'au Zambèze -, était livré aux chasses à
l'homme et à la vente de captifs. Cet espace grand comme deux fois l'Europe,
certains explorateurs évaluaient sa population au XIXe siècle, à environ cent
millions d'âmes. Pour avoir une idée du mal, il faut savoir que ces mêmes
observateurs, avaient constaté que pour chasser et enlever de force cinq cent
mille individus, il fallait en faire périr près de deux millions d'autres
(résistants ou fuyards). Ainsi, si les naissances avaient cessé à l'époque, en
moins d'un demi-siècle, les régions de l'intérieur de l'Afrique ne seraient
plus de nos jours, qu'une solitude désolée.
Vous
parlez également d'un génocide. Pensez-vous qu'il y a eu une volonté d'anéantir
les populations négro-africaines ?
Je trouve
en effet le terme de "génocide" adapté à cette entreprise sans
précédents. Il faut dire que le mépris des Arabes envers les Africains fut
aussi un catalyseur. Le célèbre historien arabe du XIVe siècle, Ibn-Khaldum,
écrivait : "Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres,
en raison d'un degré inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du
stade animal." La question qui se posait donc, était de savoir,
comment faire pour que ces "animaux", ne se reproduisent pas en
terres arabo-musulmanes. Car dès les débuts de cette traite, les négriers
voulaient empêcher qu'ils ne fassent souche. Comme cela n'avait rien de
métaphysique, la castration apparaissait comme une solution bien pratique.
Ainsi, dans cette entreprise d'avilissement d'êtres humains, si les Arabes
destinaient la plupart des femmes noires aux harems, ils mutilaient les hommes,
par des procédés très rudimentaires et qui causaient une effroyable mortalité.
Les chiffres de cette traite sont tout simplement effrayants.
Comprendre
le passé, c'est interpréter singulièrement le présent et entreprendre l'avenir
avec plus de clairvoyance. Or, les fondements et les conséquences de la traite
transsaharienne entachent encore certaines régions du monde et entretiennent
les querelles d'historiens et d'idéologues. Comme un processus qui se perpétue
à travers le temps et les hommes : le Darfour, aujourd'hui ensanglanté, ancien
gisement d'esclaves ; le silence des gouvernements arabo-musulmans à Durban au
sujet de leurs responsabilités dans la traite d'hier et d'aujourd'hui ;
l'impossibilité d'évoquer l'ensemble des acteurs de l'esclavage, etc. C'est à
toutes ces problématiques que Tidiane N'Diaye a accepté de réagir avec
sincérité et engagement.
Comment avez-vous vécu la polémique autour du livre
d'Olivier Petre-Grenouilleau ?
Olivier Petre-Grenouilleau est un confrère pour qui j'ai beaucoup de respect et qui comme tout
chercheur objectif, a fait son travail sans haine ni passion. J'ai tout
simplement regretté qu'il n'ait pas diversifié ses sources. Aussi, les griots
historiens oraux et véritables mémoires vivantes des peuples noirs, nous
apprennent, qu'avant l'arrivée des Arabes, le système d'asservissement
préexistant en Afrique subsaharienne, qualifié à tort de "traite ou
d'esclavage interne", était plutôt du servage, sous formes agricole,
domestique ou militaire. Ce système était donc une institution de domesticité
aussi diversifiée qu'accentuée. Celle-ci se différenciait de l'esclavage de
plantation américain. En fait, beaucoup d'administrateurs civils ou de
militaires coloniaux refusaient au système africain le terme d'esclavage. Ils
insistaient sur l'aspect personnel des rapports entre le maître et le captif.
Depuis des temps immémoriaux, un système de servage était pratiqué en Afrique,
c'est un fait. Mais il n'avait rien de commun, en but et en proportion, avec
celui des "visiteurs" arabo-musulmans. Sur le sujet,
Petre-Grenouilleau aurait dû intégrer aussi ces sources africaines. Son travail
a abusivement mis sur un même plan le servage interne africain, la traite
transatlantique ainsi que celle, tout simplement génocidaire, arabo-musulmane.
Pour vous le conflit au Darfour s'inscrit-il dans
la continuité de l'esclavage et du génocide ?
Sur ce sujet, les faits parlent d'eux-mêmes. En avril 1996, l'envoyé
spécial des Nations unies pour le Soudan, faisait état d'une "augmentation
effrayante de l'esclavagisme, du commerce des esclaves et du travail forcé au
Soudan." En juin de la même année, deux journalistes du Baltimore
Sun qui s'étaient également introduits au Soudan, écrivaient dans un
article intitulé 'Deux témoins de l'esclavage' qu'ils avaient réussi à acheter
deux jeunes filles esclaves, pour les affranchir. Je serais donc tenté de dire
: du Darfour au Darfour, l'horreur continue avec cette fois le nettoyage
ethnique en plus.
C'est ce qui justifie ce silence autour de la
traite négrière transsaharienne - à Durban, par exemple ? Est-ce une
conséquence de ce que vous appelez le syndrome de Stockholm à l'africaine ?
Très nombreux sont ceux qui souhaiteraient voir la traite arabo-musulmane
recouverte à jamais du voile de l'oubli, souvent au nom d'une certaine
solidarité religieuse, voire idéologique. C'est en fait un pacte virtuel scellé
entre les descendants des victimes et ceux des bourreaux, qui aboutit à ce
déni. Parce que dans cette sorte de "syndrome de Stockholm à
l'africaine", tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident. Ce
silence sélectif entourant le crime arabo-musulman envers les peuples noirs et
sa sous-estimation, pour mieux braquer les projecteurs uniquement sur la traite
transatlantique, est un ciment devant réaliser la fusion des Arabes et des
populations négro-africaines - longtemps "victimes solidaires" du
colonialisme occidental. Que des lettrés et autres intellectuels
arabo-musulmans tentent de faire disparaître jusqu'au simple souvenir de cette
infamie, comme si elle n'avait jamais existé, peut être aisément
compréhensible.
En revanche, il est difficile de comprendre l'attitude de nombreux chercheurs -
et même d'Africains américains qui se convertissent de plus en plus à l'Islam
-, qui n'est pas toujours très saine et fortement animée par une sorte
d'autocensure. Comme si évoquer le passé négrier des Arabo-musulmans, revenait
à essayer de minimiser la traite transatlantique.
La spécificité de votre démarche ne réside-t-elle
pas dans la volonté paradoxale de ne jamais figer l'histoire du peuple noir
dans l'image de victime des traites négrières au profit d'une glorification des
résistances et des anciens royaumes (Ghana, Mali, etc.) ?
J'ai toujours l'habitude de rappeler que mon travail ne cherche à communautariser
ni l'histoire ni les mémoires. Ce qui serait la porte ouverte à une
hiérarchisation victimaire, donc dénuée de tout caractère scientifique. Voilà
pourquoi au risque de déplaire, je ne cherche jamais à travestir ou à embellir
tel ou tel fait historique. J'ai été critiqué pour n'avoir pas seulement montré
le côté héroïque et révolutionnaire social de Chaka Zoulou. Ces détracteurs me
reprochaient d'avoir démoli le mythe du surhomme. En fait ce n'est pas
spécifique aux Africains mais une des mystifications de l'histoire humaine est
que les peuples ont toujours perçu leurs meneurs comme des êtres d'une
supériorité culturelle et intellectuelle qui les placent au-dessus de tout
concept moral préétabli. Alors que le concept de surhomme développé par Nietzsche
et récupéré par la plupart des dictateurs, relève plus de la fiction
grammaticale que d'une quelconque réalité. Tous les héros africains, grecs ou
romains n'en demeurent pas moins l'image ou le reflet de l'homme ordinaire.
Mais d'un homme ordinaire poussé à ses extrêmes, qui révèle toute sa bestialité
et sa démesure. A la tête de leurs armées, ces meneurs n'ont eu recours qu'à la
force.
C'est le cas de Chaka Zoulou ?
Il a écrasé des peuples qui refusaient d'avancer avec lui. Sa route est
jalonnée de morts et de destructions. Car le souverain zoulou n'était pas que
ce héros, bâtisseur de nation et réformateur social, il a aussi accompli un
détestable nettoyage ethnique. Certains auteurs ont volontairement choisi de ne
jamais évoquer cet aspect de l'épopée du conquérant zoulou. De même que pour ce
qui est de la traite arabo-musulmane, la plupart des chercheurs africains ont
du mal à passer d'une vision mémorielle affective de ce génocide, à tout simplement
une approche distanciée et scientifique de l'histoire qui elle, ne traite que
de faits avérés sans militantisme, haine ou passion. J'ai personnellement
choisi cette dernière voie pour tous les sujets que j'ai traités jusqu'ici.
La lettre d'Eurosud n°136 - 7 mars 2009
|
 Interview
de Tidiane N'Diaye :
Interview
de Tidiane N'Diaye : Interview
de Tidiane N'Diaye :
Interview
de Tidiane N'Diaye :